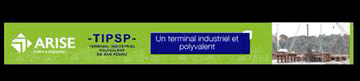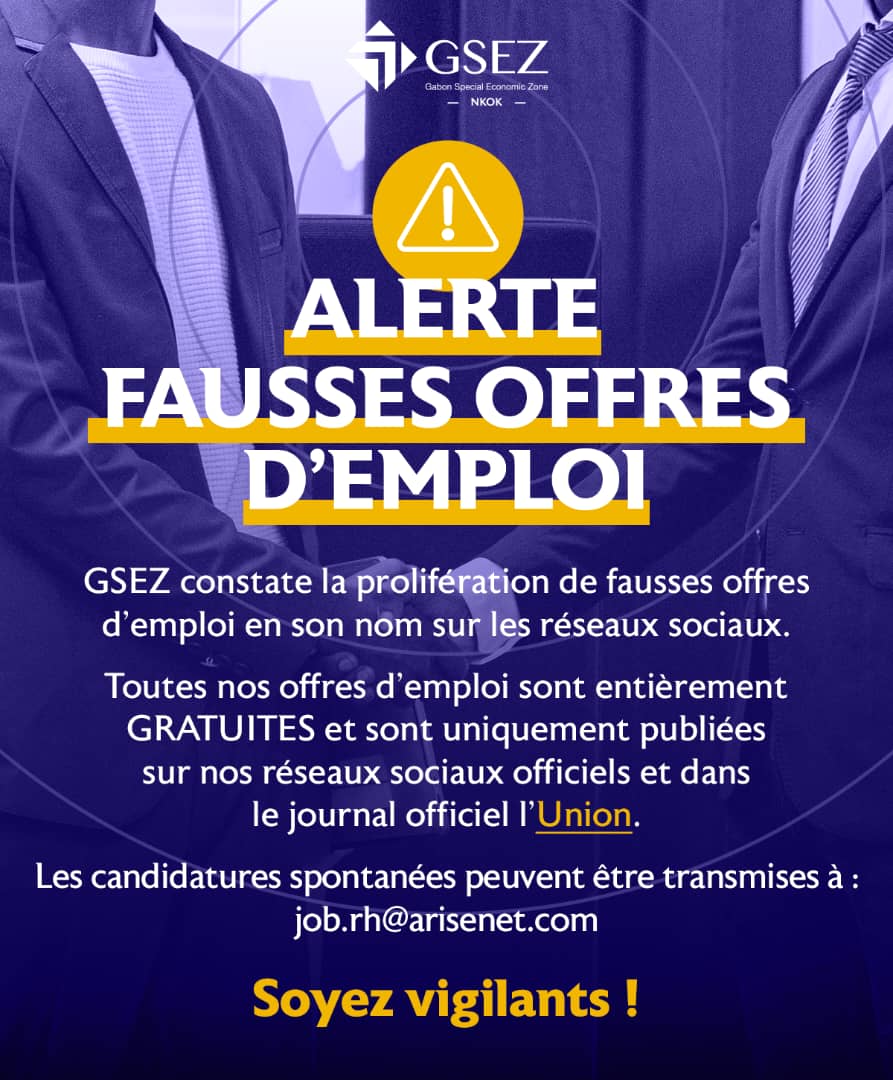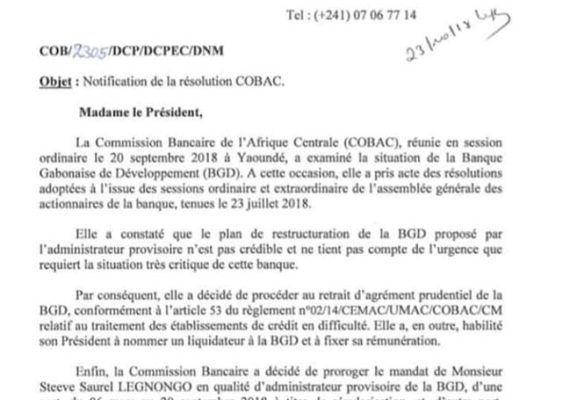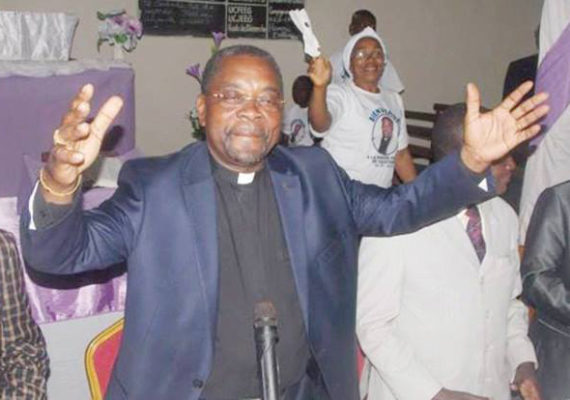Télesphore ONDO* et Clyde MBADINGA**
Télesphore ONDO* et Clyde MBADINGA**
Depuis la prise du pouvoir le 30 août 2023 par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), le Gabon vit dans un régime de transition sans pareil avec la signature d’une charte de la transition le 2 septembre 2023. Cette charte constitue, avec la Constitution du 26 mars 1991, les principaux textes qui encadrent l’exercice du pouvoir pendant la transition. Ils forment ce qu’il convient d’appeler le pluralisme constitutionnel.
Le pluralisme constitutionnel est la coexistence hiérarchique, conflictuelle, pacifique, harmonieuse, cohérente de deux ou plusieurs Constitutions dans une société pluraliste donnée, dans un contexte donné et qui ont pour objet de réguler le fonctionnement des institutions publiques.
Le pluralisme constitutionnel est un phénomène normal dans les Etats fédéraux avec une Constitution fédérale qui cohabite avec les Constitutions des Etats fédérés. Il semble désormais s’imposer également dans les Etats unitaires dans lesquels la Constitution règne habituellement en solitaire. En effet, le monisme constitutionnel apparaît de plus en plus comme un phénomène rare, voire introuvable dans les sociétés contemporaines. En réalité, en droit constitutionnel, la Constitution a toujours été et reste toujours plurielle : Constitution écrite et Constitution non écrite ; Constitution rigide et Constitution souple ; Constitution formelle et Constitution matérielle ; Constitution visible et Constitution invisible ; Constitution normative et Constitution jurisprudentielle ; Constitution juridique et Constitution sociologique ; Constitution politique et Constitution sociale, etc.
Même le bloc de constitutionnalité a toujours été pluriel : corpus de la Constitution de 1991, Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples de 1981, Charte nationale des libertés de 1990, lois organiques, règlements des Assemblées parlementaires et des AAI, lois organisant un droit fondamental prévu par la Constitution, objectifs, exigences et principes de valeur constitutionnelle.
Dans le contexte de la transition, le pluralisme constitutionnel se complexifie. En effet, le régime de la transition vit au rythme d’un bi-constitutionnalisme inédit : la charte de la transition, encore appelée « petite Constitution » ; « Constitution provisoire » ; « Constitution intérimaire », etc., et la Constitution de 1991.
Traditionnellement, les rapports entre normes reposent sur le principe hiérarchique, développé par Hans Kelsen, selon lequel les normes inférieures doivent être conformes aux normes supérieures placées au sommet de la pyramide sous le contrôle du juge constitutionnel.
Ce principe est transcendant et s’impose avec vigueur au régime de la transition, mais sous sa forme renversée.
En effet, dans le régime transitionnel, ce principe subit un bouleversement au profit de la charte. C’est ce que traduit l’article 61 de la charte de la transition : « en cas de contrariété entre la charte de la transition et la Constitution du 26 mars 1991, les dispositions de la présente charte s’appliquent ». Ce principe de primauté de la charte sur la Constitution a été confirmé et renforcé par la Cour constitutionnelle de la transition dans sa décision n° 035/CCT du 27 novembre 2024. Selon la Cour, « l’article 61 consacre la suprématie de la charte sur la Constitution » et, mieux, la charte de la transition est un « texte à valeur supra constitutionnelle durant la période de la transition ».
Parallèlement à cette position complexe de la Cour, le pluralisme constitutionnel initial est renforcé par l’application partielle de la nouvelle Constitution gabonaise du 19 décembre 2024, avant son entrée en vigueur intégrale, après l’élection du président de la République, conformément aux articles 172 et 173 dudit texte. L’application de certaines dispositions de cette Constitution, qui a vocation à abroger la Constitution de 1991, n’a pas moins pour conséquence de conforter le constat d’un pluralisme constitutionnel actuellement en action, caractérisé désormais par la coexistence de trois textes constitutionnels pendant la transition.
La mise en œuvre de ce tri-constitutionnalisme soulève déjà des difficultés qui présagent un désordre constitutionnel imminent, notamment :
– la référence désordonnée à ces Constitutions : par exemple,
* l’arrêté n° 0002392/MIS du 26 décembre 2024 fixant la période de révision de la liste électorale et l’arrêté n° 0002403/MIS du 26 décembre 2024 fixant les attributions, le nombre et les modalités de fonctionnement des commissions d’enrôlement se réfèrent uniquement à la Constitution du 19 décembre 2024 ;
* la décision n° 002/CCT du 22 janvier 2025 de la Cour constitutionnelle de la transition relative au contrôle de constitutionnalité de la loi organique n° 001/2025 portant code électoral en République gabonaise se réfère à la charte de la transition, à la Constitution (sans préciser laquelle), à sa loi organique de 1991 et à son règlement de procédure, textes à valeur constitutionnelle pris conformément à la Constitution de 1991 ;
– la question de la hiérarchie entre les trois Constitutions va se poser avant et après l’élection présidentielle avec l’application intégrale de la Constitution de 2024.
Dans ce paysage constitutionnel sui generis, les institutions normales (le président élu, les vice-présidents et le gouvernement) et les autorités de la transition (le Parlement, la Cour constitutionnelle et le Conseil économique, social et environnemental) sont appelées à jouer un rôle majeur pour garantir la cohabitation harmonieuse de ces différentes normes fondamentales et, partant, la cohérence globale du système normatif. Cette tâche n’est, cependant, pas des plus aisées au regard d’un certain nombre d’éléments. L’un des plus marquants est la consécration par la Cour constitutionnelle, dans sa décision précitée, d’une supra-constitutionnalité qui laisse, néanmoins, une partie de la doctrine perplexe. La question de savoir si les rapports entre ordres normatifs ne peuvent se limiter qu’au seul principe hiérarchique en constitue la principale pierre d’achoppement. D’autant que la Constitution elle-même semble établir une hiérarchie dès lors que certains de ses articles bénéficient d’une sorte de sanctuarisation et ne peuvent être modifiés. Mieux, la jurisprudence constitutionnelle elle-même (hors transition et de la transition) a fait évoluer les choses en faisant une classification des normes constitutionnelles.
Par ailleurs, concomitamment à cette évolution, le juge constitutionnel, en dégageant des normes, principes, exigences et objectifs constitutionnels, utilise souvent soit la mise en balance, soit la proportionnalité ou d’autres règles de conciliation destinées à régir les rapports normatifs afin d’éviter des conflits de normes éventuellement préjudiciables à l’Etat de droit.
Au regard de ce qui précède, il apparaît que les rapports entre normes juridiques ne peuvent plus être appréhendés uniquement sous le prisme du principe hiérarchique, surtout dans le contexte du pluralisme constitutionnel. Devant cette situation complexe qui pourrait bloquer la machine institutionnelle, il apparaît nécessaire de faire des propositions pour aider les institutions de la transition et celles à venir à mieux gérer ce pluralisme constitutionnel et prévenir d’éventuels conflits. Pour ce faire, les pistes suivantes peuvent être explorées :
1- réviser la charte de la transition pour supprimer :
* toutes les dispositions faisant référence à la Constitution du 26 mars 1991, qui doit disparaître, pour les renvoyer à la Constitution du 19 décembre 2024 ;
* l’Exécutif dans la charte de la transition qui sera la première institution à être mise en place et à exercer pleinement ses attributions conformément à la nouvelle Constitution de 2024 ;
* le CTRI qui n’aura plus aucune utilité après l’élection du nouveau chef de l’Etat et qui ne figure pas parmi les institutions de la transition devant demeurer en place aux termes de l’article 171 de la nouvelle Constitution, notamment le Parlement de la transition, la Cour Constitutionnelle de la transition et le Conseil économique, social et environnemental de la transition ;
2- réviser l’article 61 de la charte dans le sens du rétablissement de l’ordre constitutionnel pour que la Constitution de 2024 prime sur la charte et enrichisse le contenu de cette disposition en y ajoutant d’autres principes de conciliation. L’intérêt de cette ré-écriture est de prévenir les problèmes d’applicabilité de certaines dispositions susceptibles de survenir lorsqu’il sera, quelques fois, nécessaire d’appliquer prioritairement la Charte pour garantir le fonctionnement régulier des organes de la transition qui resteront en place. Ainsi, en cas de survenance d’un conflit des normes porté devant la Cour constitutionnelle de la transition, celle-ci pourrait, sans appliquer de manière systématique le principe de suprématie de la Constitution, privilégier d’autres principes en procédant à un arbitrage permanent des dispositions en conflit. Dans cette perspective, la rédaction de cette disposition serait envisagée comme suit : « en cas de contrariété entre la Constitution du 19 décembre 2024 et la Charte de la transition du 2 septembre 2023, la Cour constitutionnelle de la transition statue en appliquant, suivant les cas, les principes de primauté de la Constitution, de conciliation, de proportionnalité, de lex specialis, de lex posterior, de subsidiarité, de complétude mutuelle et d’hybridation ».
Le pluralisme constitutionnel impliquerait ainsi l’application d’une pluralité de principes nécessaires pour prévenir tout conflit de normes dans un Etat de droit démocratique.
*Télesphore Ondo, professeur de droit public à l’Université Omar Bongo, directeur du Crecappi
**Clyde Mbadinga, doctorant et Ater en droit public à l’Université de Montpellier, membre du
Crecappi